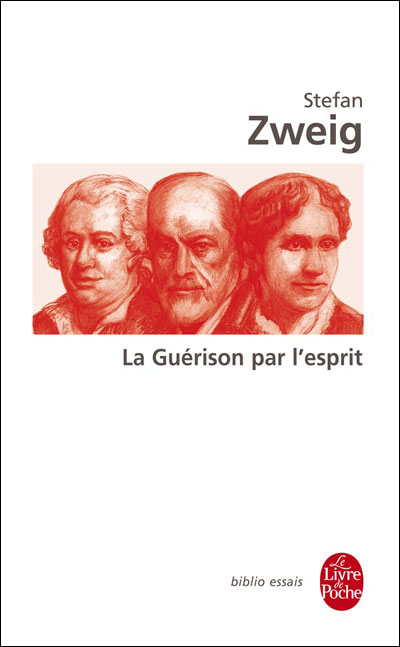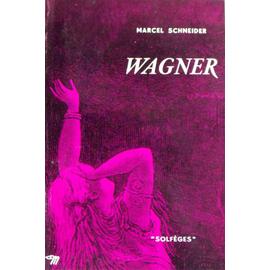Ce printemps 2011 a été esthétiquement et législativement inscrit sous le signe de la folie. L'art des fous qu'on appelle pudiquement art brut continue d'entrer dans les institutions muséales (La Maison Rouge à Paris, le LAM de Villeneuve d'Ascq), le tout premier festival d'histoire de l'art portait sur ce thème (dont l'affiche est hideuse) et même Grande Galerie, le magazine du Louvre dans son n°16 aborde la question. On y trouve une proposition de reconstitution d'un retable de Bosch, comportant la célèbre Nef des fous. Je la trouve pour le moins surprenante, mais comment être sur de quoique ce soit avec Bosch ?
Ce printemps 2011 a été esthétiquement et législativement inscrit sous le signe de la folie. L'art des fous qu'on appelle pudiquement art brut continue d'entrer dans les institutions muséales (La Maison Rouge à Paris, le LAM de Villeneuve d'Ascq), le tout premier festival d'histoire de l'art portait sur ce thème (dont l'affiche est hideuse) et même Grande Galerie, le magazine du Louvre dans son n°16 aborde la question. On y trouve une proposition de reconstitution d'un retable de Bosch, comportant la célèbre Nef des fous. Je la trouve pour le moins surprenante, mais comment être sur de quoique ce soit avec Bosch ?Par ailleurs, les administratifs français cherchent à pénaliser de plus en plus les aliénés, comme si leur état n'était pas une maladie mais un choix dans lequel ils se complairaient ! Il y a quelque chose d'abject à s’extasier devant des œuvres en ignorant dans quelles conditions de vie sociale et de souffrances elles ont été produites. Sont-ce même des œuvres ? Il y a là une véritable réflexion à mener sur le statut de ces productions.
La revue L'Histoire (dans ses hors-séries appelés Les Collections, n°51 d'avril 2011) a sorti un numéro sur La Folie. Bien quelle sous-titre d’Érasme à Foucault, les articles traitent également de la folie dans l'Antiquité et à l'époque contemporaine. De plus, le numéro comporte un titre complémentaire : Depuis quand a-t-on peur des fous ? Il est clair que cette revue cherche à éclairer la situation française actuelle, qui, malheureusement, fait l'objet de trop peu de débat au sein de la société et de la classe politique. L'intérêt est double : les auteurs appartiennent à des disciplines différentes : historiens, philosophes, psychiatres et les images sont nombreuses, de bonne qualité et souvent inédites. Voici un résumé de la structure du numéro par CL, stagiaire (les pauvres stagiaires sont réduits à des initiales !!!) sur le blog du CEDOC Jean Piaget :
Ce numéro est divisé en trois grands chapitres. Le premier éclaire le lien entre folie et divinité qui était surtout présent dans l'antiquité, mais qui est toujours présent dans certains endroits du monde où la mythologie est encore présente, contrairement à la science.
Le deuxième chapitre expose la perception de la folie au Moyen Age. Dans cette grande période de l'histoire européenne le fou rimait bien souvent avec sagesse. On peut prendre comme exemple le personnage du bouffon du roi qui était le seul à pouvoir critiquer ouvertement le roi et dont les critiques contenaient une certaine forme de sagesse camouflée. Toujours au Moyen Age, la folie était souvent interprétée comme une souffrance amoureuse.Le troisième chapitre se penche sur un cas tristement célèbre: celui des asiles. Sur ce sujet, il y a de nombreux avis qui divergent. Doit-on enfermer un individu qualifié de fou ou est-ce l'enfermement qui rend fou? La société est-elle victime des fous ou au contraire est-elle à l'origine de la folie de par son caractère répressif, inégalitaire et intolérant?
Dans l'ensemble donc une bonne introduction à cette question avec une excellente intervention du philosophe Marcel Gauchet pour éclairer le débat. Heureusement que certains continuent l'effort de penser !
Je me suis lancé à la suite de cette revue dans la lecture de ce grand classique humaniste qu'est l’Éloge de la folie d’Érasme. Elle est finalement bien raisonneuse cette folie qui est sensée parler... Elle se révèle bien philosophe finalement. A l'intention de mes élèves, j'ai relevé et mis en ligne sur mon blog pédagogique une série d'extraits se rapportant aux notions au programme. La philosophie et la folie entretiennent des rapports aussi anciens que la philosophie elle-même : la première n'est-elle pas une forme de la dernière ? De quoi est taxé le prisonnier qui, après avoir été libéré de la caverne de Platon (République, livre 7) et ayant ainsi découvert la vérité de la réalité, revient parmi ses anciens codétenus ? : de folie. Pour creuser la question on peut lire article (assez ardu) de Rémi Brague Le fou stoïcien dans le recueil Introduction au monde grec chez Champs Essais. Le grand paradoxe, l'échec, pourrait-on dire de l'apologie partiellement ironique de la folie faite par Érasme est qu'elle ne suscite pas la folie... Au contraire cette lecture stimule la lecture analytique du monde et des comportements humains. N'est-ce pas la raison raisonneuse qui se cache sous le masque de la folie ?
Dès qu'on a commencé à considérer la folie comme un état pathologique et non pas comme une transe sacrée, on a cherché des remèdes, des cures, des thérapies. Or ces dernières n'ont pas toujours été physiques, matérielles, mais aussi psychiques. C'est à l'histoire de ces cures mentales que Zweig s'est attaché dans un excellent recueil de trois biographies intellectuelles : La guérison par l'esprit. Il y traite, dans l'ordre chronologique, de Mesmer, de Mary Baker-Eddy et de Freud. Il ne s'agit pas d'un travail uniquement historique, car Zweig intervient très souvent dans le récit pour porter des jugements de valeur. Surtout à propos de Mary Baker-Eddy. Quel destin extraordinaire ! Zweig construit son récit de cette sorte qu'on reste surpris du succès d'une femme aussi médiocre intellectuellement et humainement. En même temps, il dresse ainsi le portrait de la fondatrice de la Christian Science (je ne peux m’empêcher de voir là plus qu'un oxymore : une contradiction dans les termes), qui me semble être aussi peu chrétienne que scientifique, mouvement proprement américain. Rien de tel ne s'est développé sur le continent européen. Le point de vue de Zweig sur Mesmer et Freud est très différent. Il s'attache à réhabiliter la mémoire et les découvertes, si dénigrées, de Mesmer, en montrant que sans ses essais, rien de la psychologie moderne, et tout particulièrement de la psychanalyse, n'aurait été possible. Quant à Freud, Zweig semble tout acquis à la cause freudienne. Il faut dire qu'il écrit alors que le maître de Vienne est toujours en vie, qu'il a derrière lui, l'aura de sa carrière et de ses écrits.
On jugera de l'intérêt relatif de chacune des 3 parties par le nombre de post-it que j'y ai apposé.
Qui cherche à comprendre l'hypothèse freudienne dans le cadre des connaissances de son époque ainsi que la théorie elle-même trouvera ici un très bon résumé. De même dans l'introduction de ce recueil Zweig propose une hypothèse où la religion et la médecine ont des origines communes. Une généalogie commune, pour le moins originale.
Dès qu'on a commencé à considérer la folie comme un état pathologique et non pas comme une transe sacrée, on a cherché des remèdes, des cures, des thérapies. Or ces dernières n'ont pas toujours été physiques, matérielles, mais aussi psychiques. C'est à l'histoire de ces cures mentales que Zweig s'est attaché dans un excellent recueil de trois biographies intellectuelles : La guérison par l'esprit. Il y traite, dans l'ordre chronologique, de Mesmer, de Mary Baker-Eddy et de Freud. Il ne s'agit pas d'un travail uniquement historique, car Zweig intervient très souvent dans le récit pour porter des jugements de valeur. Surtout à propos de Mary Baker-Eddy. Quel destin extraordinaire ! Zweig construit son récit de cette sorte qu'on reste surpris du succès d'une femme aussi médiocre intellectuellement et humainement. En même temps, il dresse ainsi le portrait de la fondatrice de la Christian Science (je ne peux m’empêcher de voir là plus qu'un oxymore : une contradiction dans les termes), qui me semble être aussi peu chrétienne que scientifique, mouvement proprement américain. Rien de tel ne s'est développé sur le continent européen. Le point de vue de Zweig sur Mesmer et Freud est très différent. Il s'attache à réhabiliter la mémoire et les découvertes, si dénigrées, de Mesmer, en montrant que sans ses essais, rien de la psychologie moderne, et tout particulièrement de la psychanalyse, n'aurait été possible. Quant à Freud, Zweig semble tout acquis à la cause freudienne. Il faut dire qu'il écrit alors que le maître de Vienne est toujours en vie, qu'il a derrière lui, l'aura de sa carrière et de ses écrits.
On jugera de l'intérêt relatif de chacune des 3 parties par le nombre de post-it que j'y ai apposé.
Qui cherche à comprendre l'hypothèse freudienne dans le cadre des connaissances de son époque ainsi que la théorie elle-même trouvera ici un très bon résumé. De même dans l'introduction de ce recueil Zweig propose une hypothèse où la religion et la médecine ont des origines communes. Une généalogie commune, pour le moins originale.