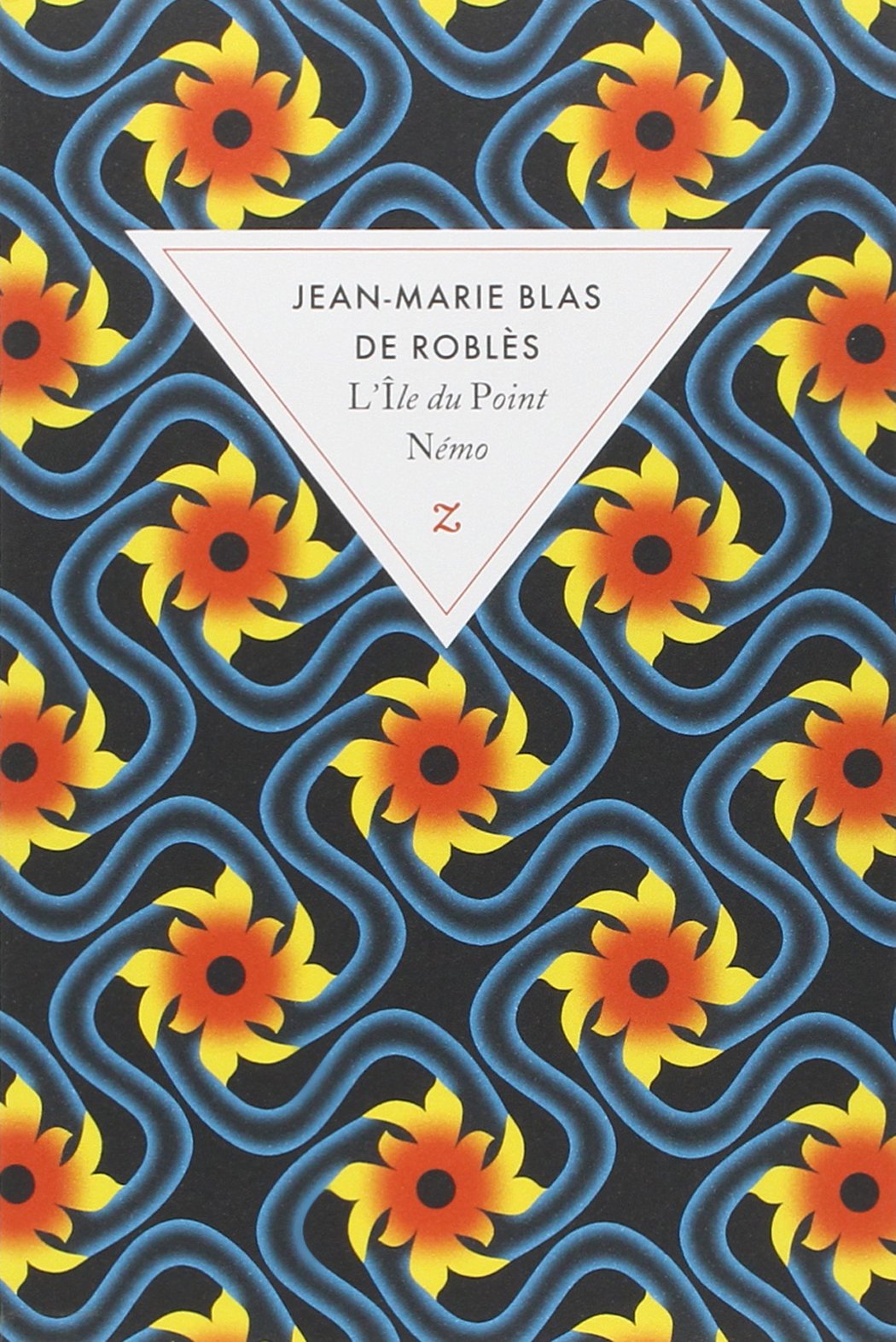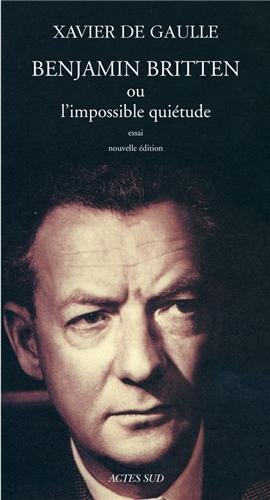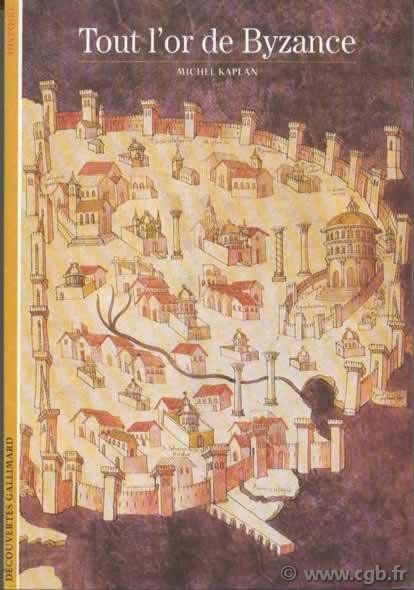Quelques notes sur des lectures faites à l’automne-hiver 2014.
Pour commencer une belle et juste citation : « Que reste-t-il dans nos mémoires sinon un résumé flou et poussiéreux, de ces livres qui ont bouleversé notre existence ? » (p. 46). Cette phrase ne s’applique pas du tout au roman dont elle est tirée, L’Île du Point Némo de Jean-Marie Blas de Roblès ! Son premier roman Là où les tigres sont chez eux m’avait vraiment emballé. Le style et la construction d’ensemble suscitaient une admiration légitime. Mais là, malgré un début assez accrocheur, je me suis vite lassé. A plus de la moitié du roman, les différentes histoires, qu’on imagine reliées entre elles, ne le sont toujours pas. Et quand elles le sont, cela déçoit. Les personnages oscillent entre le pathologique et la caricature. Une histoire est particulièrement scabreuse et tombe dans l’absurdité sans intérêt. Il me semble que l’auteur a cédé à une tendance qu’on pouvait voir en germe dans son précédent opus. Le roman se clôt sur une sorte de morale, assez obscure.
Le Sermon sur la chute de Rome de Jérôme Ferrari m’a moins déçu. L’ambition de ce roman n’en est pas moindre (délivrer une regard sur notre monde, et surtout sur la France), mais le style est particulièrement travaillé, très écrit et âpre. Cette vision noire, désenchantée de l’intelligence, des relations humaines, de l'amitié est servie par une écriture riche et brillante, des phrases très structurées à la scansion marquée, produisant une petite musique. Un passage ma particulièrement marqué (au 2e « chapitre », p. 60 sqq.) sur la désillusion éprouvé par l’un des personnages suite à ses études de philosophie à Paris. J’ai vécu la même chose et je crois que quiconque se consacre à la philosophie en vient, à un moment ou à un autre, à ce genre de pensée, qu’il faut, tant bien que mal dépasser (au sens de l’allemand aufheben).
Enfin, le gagnant dans la catégorie couverture presse mais le perdant de tous les prix littéraires officiels : Le Royaume d’Emmanuel Carrère. Premier contact avec cet auteur réputé et sur un thème que je connais bien pour l’avoir étudié : les origines du christianisme. Hormis la presse, l’absence de prix décerné à cet ouvrage, que je ne qualifierai pas de roman, me semble on ne peut plus légitime. Il s’agit à la fois d’un témoignage, celui d’un homme qui a eu foi au christianisme à un moment de sa vie, et d’un ouvrage de vulgarisation sur le christianisme primitif. Pour ce dernier aspect, je le recommanderai à mes élèves et à toute personne cherchant une première lecture d’initiation aux premiers temps de l’église chrétienne. En effet, Emmanuel Carrère parvient à faire de Paul, de Luc et leurs cercles, des personnages vivants dont on suit avec intérêt les actions. Comparé à une littérature scientifique sur la question, il va sans dire que la lecture est plus agréable. En tant que romancier, il peut en effet se permettre ce qu’aucun historien ne tenterait sans scrupule. Comme le résume très bien le quatrième de couverture : ni romancier, ni historien, enquêteur.
Quant au récit de sa conversion. Quel en est véritablement l’intérêt ? Si ce n’était pas Monsieur Emmanuel Carrère qui nous parlait de lui, mais un illustre inconnu, le texte serait moins intéressant. Ce n’est après tout qu’un témoignage très personnel. Qu’une personne cherche à comprendre les raisons d’une décision, d’un changement dans sa vie, d’une conversion et que pour cela elle se mette à écrire, je le comprends parfaitement, mais quel est l’objectif visé dès lors qu’il y a publication ? Ne s’agit-il pas que d’une forme raffinée d’exhibitionnisme, un narcissisme en société ? Sinon, pourquoi Monsieur Carrère, nous rappelle-t-il les difficultés à trouver sa résidence secondaire en Méditerranée ? Pourquoi évoquer ses vacances en Grèce et sa participation au festival de Cannes ?
Par ailleurs, il tient des propos qui sont tout simplement faux. Il affirme page 211 : "Les hommes sont ainsi fait qu'ils veulent - pour les meilleurs d'entre, ce n'est déjà pas rien - du bien à leurs amis et, tous, du mal à leurs ennemis. Qu'ils aiment mieux être forts que faibles, riches que pauvres, grands que petits, dominants plutôt que dominés. C'est ainsi, c'est normal, personne n'a jamais dit que c'était mal. La sagesse grecque ne le dit pas, la piété juive en plus. Or voici que des hommes non seulement disent mais font exactement le contraire." Comment un homme aussi cultivé que Monsieur Carrère peut-il affirmer de façon aussi péremptoire que pas un mot de la philosophie grecque ne prend position contre l’injustice des hommes consistant en une forme d’égoïsme bien calculé ? Il n’est qu’à lire Gorgias de Platon. Cette citation pourrait être mise dans la bouche de Calliclès sans en changer une ligne. Or toute la démarche de Socrate dans ce dialogue et la finalité dernière de la philosophie de Platon consistent justement à montrer les limites d’une telle conception et à poser d’autres normes que cette normalité de l’égoïsme et de l’injustice.
Des lectures bien différentes mais dont aucune ne m’a ni vraiment convaincu, ni vraiment enthousiasmé.