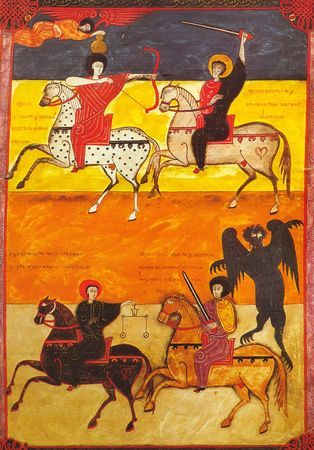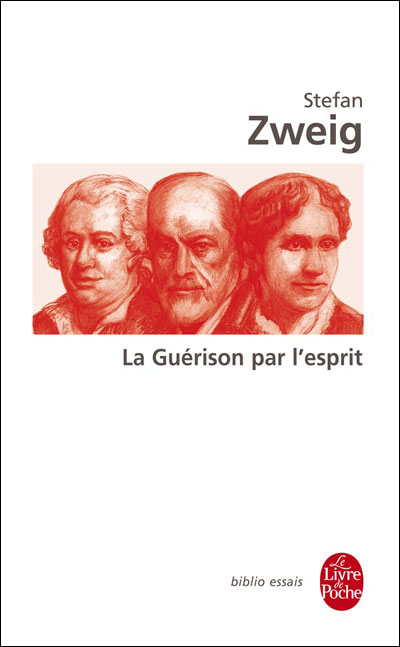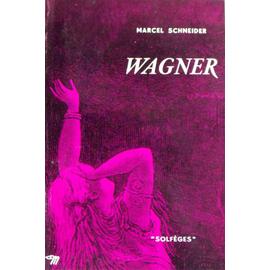Je voudrais profiter du compte-rendu de lecture de cet ouvrage pour rendre hommage à l'un de mes maîtres. Bien sûr, il y a les maîtres que nous avons vu enseigner, en chair en os devant nous, au gré de telle ou telle préparation à un examen ou un concours : Didier Franck, Jean-Louis Chrétien, Francis Wolf et puis il y a ceux dont seule la lecture nous délivre leur enseignement sans pour autant qu'elle masque la personne. Tel fut, pour moi, Lucien Jerphagnon, disparu en septembre 2011.
 Mon premier contact avec ses écrits se fit lors de la préparation d'un voyage scolaire à Rome. Pour réviser l'histoire romaine et pouvoir l'expliquer au milieu des ruines à mes élèves, j'avais trouvé son Histoire de la Rome antique, les armes et les mots (Hachette). Je découvris alors un érudit loin de toute pédanterie mais capable au contraire à la fois d'humour et de formules condensant toute une évolution historique. L'histoire romaine n'est plus sous sa plume une longue chronique mais une véritable aventure humaine. Charme supplémentaire, non négligeable pour moi, il accordait dans ses analyses une place importante à l'influence des philosophes sur les empereurs romains.
Lors de l'été 2008, je consacrais de nombreuses lectures à une période, ou plutôt à un mutation culturelle, qui m'intéresse toujours beaucoup : la christianisation de l'empire romain, c'est-à-dire la christianisation du monde tout court. Cette recherche essayait de trouver des éléments de réponse à une question importante pour l'histoire de la philosophie : comment expliquer que le christianisme se soit défini et ait été identifié comme la vraie philosophie? Paul essayant de prêcher à Athènes aux philosophes n'avait-il pas pourtant reçu comme réponse : "nous t'entendrons là-dessus un autre jour" (Actes des apôtres 17.32)? Des éléments de réponse se trouvent dans La toge et la mitre de Peter Brown et Les divins Césars, Idéologie et pouvoir dans la Rome antique de Jerphagnon. Deux ouvrages radicalement différents dans leurs structures et leurs styles.
Mon premier contact avec ses écrits se fit lors de la préparation d'un voyage scolaire à Rome. Pour réviser l'histoire romaine et pouvoir l'expliquer au milieu des ruines à mes élèves, j'avais trouvé son Histoire de la Rome antique, les armes et les mots (Hachette). Je découvris alors un érudit loin de toute pédanterie mais capable au contraire à la fois d'humour et de formules condensant toute une évolution historique. L'histoire romaine n'est plus sous sa plume une longue chronique mais une véritable aventure humaine. Charme supplémentaire, non négligeable pour moi, il accordait dans ses analyses une place importante à l'influence des philosophes sur les empereurs romains.
Lors de l'été 2008, je consacrais de nombreuses lectures à une période, ou plutôt à un mutation culturelle, qui m'intéresse toujours beaucoup : la christianisation de l'empire romain, c'est-à-dire la christianisation du monde tout court. Cette recherche essayait de trouver des éléments de réponse à une question importante pour l'histoire de la philosophie : comment expliquer que le christianisme se soit défini et ait été identifié comme la vraie philosophie? Paul essayant de prêcher à Athènes aux philosophes n'avait-il pas pourtant reçu comme réponse : "nous t'entendrons là-dessus un autre jour" (Actes des apôtres 17.32)? Des éléments de réponse se trouvent dans La toge et la mitre de Peter Brown et Les divins Césars, Idéologie et pouvoir dans la Rome antique de Jerphagnon. Deux ouvrages radicalement différents dans leurs structures et leurs styles.
 Le premier, chronologico-thématique, est original, difficile et très anglo-saxon. Il s'agit d'une synthèse donc pas du tout un ouvrage d'initiation : il demande de connaître déjà les grandes étapes de la période étudiée, ainsi que les structures et les forces qui y sont en jeu. D'autant plus que le découpage géographique et chronologique est particulier bien que cohérent. Il comporte des illustrations mais de piètre qualité, cependant il est doté d'une utile chronologie.
Le premier, chronologico-thématique, est original, difficile et très anglo-saxon. Il s'agit d'une synthèse donc pas du tout un ouvrage d'initiation : il demande de connaître déjà les grandes étapes de la période étudiée, ainsi que les structures et les forces qui y sont en jeu. D'autant plus que le découpage géographique et chronologique est particulier bien que cohérent. Il comporte des illustrations mais de piètre qualité, cependant il est doté d'une utile chronologie.
 Le second, de Jerphagnon donc, est aussi chronologique et analyse les rapports du pouvoir politique au sacré dans la Rome impériale, et le rôle que la philosophie a pu y jouer. Il est intéressant de voir que les césars sont devenus divins en s'inspirant d'une conception de philosophie politique et la philosophie a confirmé cette divinisation. Cette alliance est doublement
utile : le politique y trouve une forme de légitimation (toujours
nécessaire) et la religion y trouve un instrument de pouvoir (la foi ne
suffit pas toujours). L'auteur décrit chaque empereur et ce qu'il a apporté, en bien comme en mal, puis il décrit quel rôle jouaient les philosophes et la philosophie politique dans les pratiques politiques. Jerphagnon montre également que le
christianisme s'est inséré dans cette alliance du pouvoir politique et
du divin. Il y aurait une très intéressante recherche à faire sur les
formes de divinisation du politique de l'antiquité à nos jours.
Le second, de Jerphagnon donc, est aussi chronologique et analyse les rapports du pouvoir politique au sacré dans la Rome impériale, et le rôle que la philosophie a pu y jouer. Il est intéressant de voir que les césars sont devenus divins en s'inspirant d'une conception de philosophie politique et la philosophie a confirmé cette divinisation. Cette alliance est doublement
utile : le politique y trouve une forme de légitimation (toujours
nécessaire) et la religion y trouve un instrument de pouvoir (la foi ne
suffit pas toujours). L'auteur décrit chaque empereur et ce qu'il a apporté, en bien comme en mal, puis il décrit quel rôle jouaient les philosophes et la philosophie politique dans les pratiques politiques. Jerphagnon montre également que le
christianisme s'est inséré dans cette alliance du pouvoir politique et
du divin. Il y aurait une très intéressante recherche à faire sur les
formes de divinisation du politique de l'antiquité à nos jours.
 On comprend donc que Jerphagnon se soit intéressé à une figure aussi originale que Julien dit l'Apostat. Le titre indique d'emblée une approche historique, c'est-à-dire critique : il faut pour dire quoique ce soit de fondé sur Julien se débarrasser du personnage ingrat et cruel qu'en a fait une histoire apologétique chrétienne. Avant d'être Julien l'Apostat, il fut Flavius Claudius Julianus, né en 331 et mort en 363. Apostat pour les uns, il fut aussi Julien le Philosophe pour les autres, dernier empereur polythéiste, païen donc aux yeux des chrétiens. Élevé dans la foi chrétienne (arienne), il s'en détourna et cacha longtemps son retour aux dieux anciens, jusqu'à ce que ce rat de bibliothèque, nourri aux philosophes grecs, en vienne par son intelligence et son application à être proclamé empereur par ses troupes gauloises. Il put alors restaurer les anciens cultes.
On comprend donc que Jerphagnon se soit intéressé à une figure aussi originale que Julien dit l'Apostat. Le titre indique d'emblée une approche historique, c'est-à-dire critique : il faut pour dire quoique ce soit de fondé sur Julien se débarrasser du personnage ingrat et cruel qu'en a fait une histoire apologétique chrétienne. Avant d'être Julien l'Apostat, il fut Flavius Claudius Julianus, né en 331 et mort en 363. Apostat pour les uns, il fut aussi Julien le Philosophe pour les autres, dernier empereur polythéiste, païen donc aux yeux des chrétiens. Élevé dans la foi chrétienne (arienne), il s'en détourna et cacha longtemps son retour aux dieux anciens, jusqu'à ce que ce rat de bibliothèque, nourri aux philosophes grecs, en vienne par son intelligence et son application à être proclamé empereur par ses troupes gauloises. Il put alors restaurer les anciens cultes.
Le livre de Jerphagnon est un texte dont la nature doit poser problème aux historiens de profession mais qui fait pourtant les délices de l'honnête homme car tout de ce qui est dit est historiquement avéré mais la forme est celle d'un roman. Le prologue narre les derniers instants de Julien et tout l'intérêt de la lecture consiste à comprendre comment il en est arrivé à mourir lors d'une campagne contre les Perses. Je me souviens d'en avoir avalé des livres d'histoire en khâgne, plus ennuyeux les uns que les autres, enchainant les tableaux statistiques, les courbes, les relevés! Je sais bien que c'est l'histoire telle qu'elle se fait mais quel ennui! Il n'est pas impossible de capter l'attention de son lecteur, est-ce illégitime? : telle est la question! En faisant sienne l'ancienne ambition de docere, placere, movere, Jerphagnon offrait à son lecteur l'occasion de comprendre et de retenir les faits évoqués. Il me semble renouer avec le Sade de l'Histoire secrète d'Isabelle de Bavière, texte peu connu du divin Marquis et dont la préface est pourtant très intéressante concernant la question du travail de l'historien.
 On sent dans le récit de Jerphagnon à quel point il connait par des sources directes la personne de Julien. Il éprouve clairement de l'affection pour lui, sans pour autant faire preuve de complaisance à son égard. Seule une longue fréquentation des textes, permet à l’érudition de s'épurer ainsi pour gagner en clarté. On voit alors que le nom de Philosophe ne convient à Julien qu'au sens de ce que la philosophie était devenue au 4e siècle de notre ère : une pensée empreinte de mysticisme.
On sent dans le récit de Jerphagnon à quel point il connait par des sources directes la personne de Julien. Il éprouve clairement de l'affection pour lui, sans pour autant faire preuve de complaisance à son égard. Seule une longue fréquentation des textes, permet à l’érudition de s'épurer ainsi pour gagner en clarté. On voit alors que le nom de Philosophe ne convient à Julien qu'au sens de ce que la philosophie était devenue au 4e siècle de notre ère : une pensée empreinte de mysticisme.
Par leur souci de détruire la doctrine païenne, les auteurs chrétiens ont très souvent citer les auteurs qu'ils critiquaient, ainsi même si les texte de Julien (tout comme ceux de Celse), ont été détruits, il a été possible de les reconstituer. On lira avec intérêt et profit le Contre les Galiléens de Julien dans lequel il se livre à une analyse rationnelle des dogmes de la foi chrétienne en en montrant l'irrationalité ou l'infériorité comparés à la conception "philosophique" de la divinité. Les éditions Mille et une nuits proposent une traduction ancienne mais revue. On la trouve aussi sur l'excellent site remacle.org. Pour se faire une idée des arguments opposés au christianisme, l’opuscule de Celse est intéressant. On le trouve encore en occasion aux éditions Jean-Jacques Pauvert.
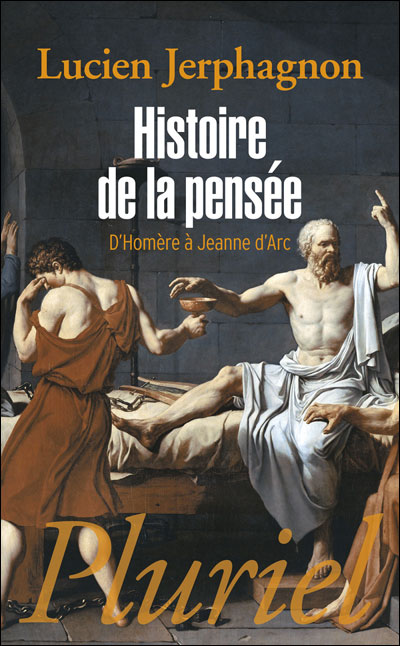 Je ne peux terminer ce compte-rendu de lecture sans indiquer la réédition de L'histoire de la pensée de Jerphagnon chez Hachette, avec le sous-titre idiot "d'Homère à Jeanne d'Arc". Initialement publié chez Tallandier, l'ouvrage fut réédité au Livre de Poche, comme le premier de trois tomes. Sous-titré Philosophies et philosophes, le premier tome porte sur l'Antiquité et le Moyen Âge. Il est dû à Jerphagnon. Les deux autres tomes (Renaissance et siècle des Lumières ; Temps modernes) sont de la plume de Jean-Louis Dumas. Pour ceux qui veulent compléter leur culture générale (par exemple dans le cadre d'un concours) mais aussi pour ceux qui, comme moi, ont besoin parfois de réorganiser leurs connaissances pour leur donner une cohérence, cette lecture est indispensable. L'érudition est indiscutable mais surtout, Jerphagnon essaie de montrer les ruptures et les continuités dans l'histoire des idées. On évite ainsi la lecture de fiches ("présocratiques", Platon, Aristote, cynisme, stoïcisme, épicurisme etc.) qui laissent l'impression que tout cela se suit sans relation aucune. Comme à son habitude, l'auteur maîtrise suffisamment son sujet pour se permettre de faire de l'humour : un bonheur supplémentaire et rare dans un ouvrage sur cette question.
Je ne peux terminer ce compte-rendu de lecture sans indiquer la réédition de L'histoire de la pensée de Jerphagnon chez Hachette, avec le sous-titre idiot "d'Homère à Jeanne d'Arc". Initialement publié chez Tallandier, l'ouvrage fut réédité au Livre de Poche, comme le premier de trois tomes. Sous-titré Philosophies et philosophes, le premier tome porte sur l'Antiquité et le Moyen Âge. Il est dû à Jerphagnon. Les deux autres tomes (Renaissance et siècle des Lumières ; Temps modernes) sont de la plume de Jean-Louis Dumas. Pour ceux qui veulent compléter leur culture générale (par exemple dans le cadre d'un concours) mais aussi pour ceux qui, comme moi, ont besoin parfois de réorganiser leurs connaissances pour leur donner une cohérence, cette lecture est indispensable. L'érudition est indiscutable mais surtout, Jerphagnon essaie de montrer les ruptures et les continuités dans l'histoire des idées. On évite ainsi la lecture de fiches ("présocratiques", Platon, Aristote, cynisme, stoïcisme, épicurisme etc.) qui laissent l'impression que tout cela se suit sans relation aucune. Comme à son habitude, l'auteur maîtrise suffisamment son sujet pour se permettre de faire de l'humour : un bonheur supplémentaire et rare dans un ouvrage sur cette question.

Une épigramme comme dernier hommage :
Ma mort n’est pas complète
Car je vis dans vos têtes.
 Mon premier contact avec ses écrits se fit lors de la préparation d'un voyage scolaire à Rome. Pour réviser l'histoire romaine et pouvoir l'expliquer au milieu des ruines à mes élèves, j'avais trouvé son Histoire de la Rome antique, les armes et les mots (Hachette). Je découvris alors un érudit loin de toute pédanterie mais capable au contraire à la fois d'humour et de formules condensant toute une évolution historique. L'histoire romaine n'est plus sous sa plume une longue chronique mais une véritable aventure humaine. Charme supplémentaire, non négligeable pour moi, il accordait dans ses analyses une place importante à l'influence des philosophes sur les empereurs romains.
Mon premier contact avec ses écrits se fit lors de la préparation d'un voyage scolaire à Rome. Pour réviser l'histoire romaine et pouvoir l'expliquer au milieu des ruines à mes élèves, j'avais trouvé son Histoire de la Rome antique, les armes et les mots (Hachette). Je découvris alors un érudit loin de toute pédanterie mais capable au contraire à la fois d'humour et de formules condensant toute une évolution historique. L'histoire romaine n'est plus sous sa plume une longue chronique mais une véritable aventure humaine. Charme supplémentaire, non négligeable pour moi, il accordait dans ses analyses une place importante à l'influence des philosophes sur les empereurs romains. Le premier, chronologico-thématique, est original, difficile et très anglo-saxon. Il s'agit d'une synthèse donc pas du tout un ouvrage d'initiation : il demande de connaître déjà les grandes étapes de la période étudiée, ainsi que les structures et les forces qui y sont en jeu. D'autant plus que le découpage géographique et chronologique est particulier bien que cohérent. Il comporte des illustrations mais de piètre qualité, cependant il est doté d'une utile chronologie.
Le premier, chronologico-thématique, est original, difficile et très anglo-saxon. Il s'agit d'une synthèse donc pas du tout un ouvrage d'initiation : il demande de connaître déjà les grandes étapes de la période étudiée, ainsi que les structures et les forces qui y sont en jeu. D'autant plus que le découpage géographique et chronologique est particulier bien que cohérent. Il comporte des illustrations mais de piètre qualité, cependant il est doté d'une utile chronologie. Le second, de Jerphagnon donc, est aussi chronologique et analyse les rapports du pouvoir politique au sacré dans la Rome impériale, et le rôle que la philosophie a pu y jouer. Il est intéressant de voir que les césars sont devenus divins en s'inspirant d'une conception de philosophie politique et la philosophie a confirmé cette divinisation. Cette alliance est doublement
utile : le politique y trouve une forme de légitimation (toujours
nécessaire) et la religion y trouve un instrument de pouvoir (la foi ne
suffit pas toujours). L'auteur décrit chaque empereur et ce qu'il a apporté, en bien comme en mal, puis il décrit quel rôle jouaient les philosophes et la philosophie politique dans les pratiques politiques. Jerphagnon montre également que le
christianisme s'est inséré dans cette alliance du pouvoir politique et
du divin. Il y aurait une très intéressante recherche à faire sur les
formes de divinisation du politique de l'antiquité à nos jours.
Le second, de Jerphagnon donc, est aussi chronologique et analyse les rapports du pouvoir politique au sacré dans la Rome impériale, et le rôle que la philosophie a pu y jouer. Il est intéressant de voir que les césars sont devenus divins en s'inspirant d'une conception de philosophie politique et la philosophie a confirmé cette divinisation. Cette alliance est doublement
utile : le politique y trouve une forme de légitimation (toujours
nécessaire) et la religion y trouve un instrument de pouvoir (la foi ne
suffit pas toujours). L'auteur décrit chaque empereur et ce qu'il a apporté, en bien comme en mal, puis il décrit quel rôle jouaient les philosophes et la philosophie politique dans les pratiques politiques. Jerphagnon montre également que le
christianisme s'est inséré dans cette alliance du pouvoir politique et
du divin. Il y aurait une très intéressante recherche à faire sur les
formes de divinisation du politique de l'antiquité à nos jours. On comprend donc que Jerphagnon se soit intéressé à une figure aussi originale que Julien dit l'Apostat. Le titre indique d'emblée une approche historique, c'est-à-dire critique : il faut pour dire quoique ce soit de fondé sur Julien se débarrasser du personnage ingrat et cruel qu'en a fait une histoire apologétique chrétienne. Avant d'être Julien l'Apostat, il fut Flavius Claudius Julianus, né en 331 et mort en 363. Apostat pour les uns, il fut aussi Julien le Philosophe pour les autres, dernier empereur polythéiste, païen donc aux yeux des chrétiens. Élevé dans la foi chrétienne (arienne), il s'en détourna et cacha longtemps son retour aux dieux anciens, jusqu'à ce que ce rat de bibliothèque, nourri aux philosophes grecs, en vienne par son intelligence et son application à être proclamé empereur par ses troupes gauloises. Il put alors restaurer les anciens cultes.
On comprend donc que Jerphagnon se soit intéressé à une figure aussi originale que Julien dit l'Apostat. Le titre indique d'emblée une approche historique, c'est-à-dire critique : il faut pour dire quoique ce soit de fondé sur Julien se débarrasser du personnage ingrat et cruel qu'en a fait une histoire apologétique chrétienne. Avant d'être Julien l'Apostat, il fut Flavius Claudius Julianus, né en 331 et mort en 363. Apostat pour les uns, il fut aussi Julien le Philosophe pour les autres, dernier empereur polythéiste, païen donc aux yeux des chrétiens. Élevé dans la foi chrétienne (arienne), il s'en détourna et cacha longtemps son retour aux dieux anciens, jusqu'à ce que ce rat de bibliothèque, nourri aux philosophes grecs, en vienne par son intelligence et son application à être proclamé empereur par ses troupes gauloises. Il put alors restaurer les anciens cultes. Le livre de Jerphagnon est un texte dont la nature doit poser problème aux historiens de profession mais qui fait pourtant les délices de l'honnête homme car tout de ce qui est dit est historiquement avéré mais la forme est celle d'un roman. Le prologue narre les derniers instants de Julien et tout l'intérêt de la lecture consiste à comprendre comment il en est arrivé à mourir lors d'une campagne contre les Perses. Je me souviens d'en avoir avalé des livres d'histoire en khâgne, plus ennuyeux les uns que les autres, enchainant les tableaux statistiques, les courbes, les relevés! Je sais bien que c'est l'histoire telle qu'elle se fait mais quel ennui! Il n'est pas impossible de capter l'attention de son lecteur, est-ce illégitime? : telle est la question! En faisant sienne l'ancienne ambition de docere, placere, movere, Jerphagnon offrait à son lecteur l'occasion de comprendre et de retenir les faits évoqués. Il me semble renouer avec le Sade de l'Histoire secrète d'Isabelle de Bavière, texte peu connu du divin Marquis et dont la préface est pourtant très intéressante concernant la question du travail de l'historien.
 On sent dans le récit de Jerphagnon à quel point il connait par des sources directes la personne de Julien. Il éprouve clairement de l'affection pour lui, sans pour autant faire preuve de complaisance à son égard. Seule une longue fréquentation des textes, permet à l’érudition de s'épurer ainsi pour gagner en clarté. On voit alors que le nom de Philosophe ne convient à Julien qu'au sens de ce que la philosophie était devenue au 4e siècle de notre ère : une pensée empreinte de mysticisme.
On sent dans le récit de Jerphagnon à quel point il connait par des sources directes la personne de Julien. Il éprouve clairement de l'affection pour lui, sans pour autant faire preuve de complaisance à son égard. Seule une longue fréquentation des textes, permet à l’érudition de s'épurer ainsi pour gagner en clarté. On voit alors que le nom de Philosophe ne convient à Julien qu'au sens de ce que la philosophie était devenue au 4e siècle de notre ère : une pensée empreinte de mysticisme. Par leur souci de détruire la doctrine païenne, les auteurs chrétiens ont très souvent citer les auteurs qu'ils critiquaient, ainsi même si les texte de Julien (tout comme ceux de Celse), ont été détruits, il a été possible de les reconstituer. On lira avec intérêt et profit le Contre les Galiléens de Julien dans lequel il se livre à une analyse rationnelle des dogmes de la foi chrétienne en en montrant l'irrationalité ou l'infériorité comparés à la conception "philosophique" de la divinité. Les éditions Mille et une nuits proposent une traduction ancienne mais revue. On la trouve aussi sur l'excellent site remacle.org. Pour se faire une idée des arguments opposés au christianisme, l’opuscule de Celse est intéressant. On le trouve encore en occasion aux éditions Jean-Jacques Pauvert.
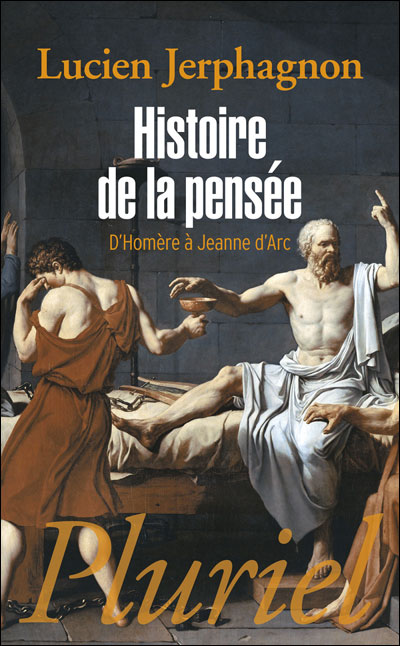 Je ne peux terminer ce compte-rendu de lecture sans indiquer la réédition de L'histoire de la pensée de Jerphagnon chez Hachette, avec le sous-titre idiot "d'Homère à Jeanne d'Arc". Initialement publié chez Tallandier, l'ouvrage fut réédité au Livre de Poche, comme le premier de trois tomes. Sous-titré Philosophies et philosophes, le premier tome porte sur l'Antiquité et le Moyen Âge. Il est dû à Jerphagnon. Les deux autres tomes (Renaissance et siècle des Lumières ; Temps modernes) sont de la plume de Jean-Louis Dumas. Pour ceux qui veulent compléter leur culture générale (par exemple dans le cadre d'un concours) mais aussi pour ceux qui, comme moi, ont besoin parfois de réorganiser leurs connaissances pour leur donner une cohérence, cette lecture est indispensable. L'érudition est indiscutable mais surtout, Jerphagnon essaie de montrer les ruptures et les continuités dans l'histoire des idées. On évite ainsi la lecture de fiches ("présocratiques", Platon, Aristote, cynisme, stoïcisme, épicurisme etc.) qui laissent l'impression que tout cela se suit sans relation aucune. Comme à son habitude, l'auteur maîtrise suffisamment son sujet pour se permettre de faire de l'humour : un bonheur supplémentaire et rare dans un ouvrage sur cette question.
Je ne peux terminer ce compte-rendu de lecture sans indiquer la réédition de L'histoire de la pensée de Jerphagnon chez Hachette, avec le sous-titre idiot "d'Homère à Jeanne d'Arc". Initialement publié chez Tallandier, l'ouvrage fut réédité au Livre de Poche, comme le premier de trois tomes. Sous-titré Philosophies et philosophes, le premier tome porte sur l'Antiquité et le Moyen Âge. Il est dû à Jerphagnon. Les deux autres tomes (Renaissance et siècle des Lumières ; Temps modernes) sont de la plume de Jean-Louis Dumas. Pour ceux qui veulent compléter leur culture générale (par exemple dans le cadre d'un concours) mais aussi pour ceux qui, comme moi, ont besoin parfois de réorganiser leurs connaissances pour leur donner une cohérence, cette lecture est indispensable. L'érudition est indiscutable mais surtout, Jerphagnon essaie de montrer les ruptures et les continuités dans l'histoire des idées. On évite ainsi la lecture de fiches ("présocratiques", Platon, Aristote, cynisme, stoïcisme, épicurisme etc.) qui laissent l'impression que tout cela se suit sans relation aucune. Comme à son habitude, l'auteur maîtrise suffisamment son sujet pour se permettre de faire de l'humour : un bonheur supplémentaire et rare dans un ouvrage sur cette question.
Une épigramme comme dernier hommage :
Ma mort n’est pas complète
Car je vis dans vos têtes.