Que lire avant de partir pour 3 semaines de vacances en Turquie, dont une semaine à Istanbul ? Et qu'emmener pour lire sur place ? Il s'agit de deux petites bibliographies très différentes, relevant de la culture d'un honnête homme moderne et non d'une bibliographie savante et sûrement très vaste sur la question.
Avant de partir, j'ai essayé de me donner un cadre historique suffisamment vaste pour y situer tout ce que nous serions amenés à voir à Istanbul, mais aussi en Cappadoce et sur la côte sud. Il me fallait donc remonter jusqu'à Constantinople et Byzance.
J'ai commencé par un ouvrage d'initiation, qui au final s'est révélé un peu trop primaire : Tout l'or de Byzance de Michel Kaplan dans la collection Découvertes Gallimard. Comme souvent dans cette collection, le format nuit à l'intérêt principal de l'ouvrage : l'iconographie. Le livre est en effet très richement illustré mais les images sont si petites ! Elles mériteraient un format plus important, d'autant plus que le livre vaut plus pour ses images que pour le texte car Kaplan a choisi une approche thématique de l'empire byzantin, approche qui ne se révèle réellement compréhensible et donc intéressante que pour ceux qui connaissent déjà un tant soit peu l'histoire de cet empire.
 Paradoxalement, pour mieux saisir ce premier livre d'initiation, je me suis donc plongé dans L'histoire de Byzance de John Julius Norwich. Dans un style très britannique, Norwich parvient à brosser les 10 siècles de cet empire, en mêlant la grande et la petite histoire (ô combien importante !) pour en comprendre la gloire et les aléas. Pour plus de détails, je vous renvoie sur le très juste commentaire d'un blogueur.
Paradoxalement, pour mieux saisir ce premier livre d'initiation, je me suis donc plongé dans L'histoire de Byzance de John Julius Norwich. Dans un style très britannique, Norwich parvient à brosser les 10 siècles de cet empire, en mêlant la grande et la petite histoire (ô combien importante !) pour en comprendre la gloire et les aléas. Pour plus de détails, je vous renvoie sur le très juste commentaire d'un blogueur.
Enfin, laissant de côté (pour le moment !) l'histoire de l'empire ottoman et pour aborder l'histoire de la Turquie moderne, j'ai lu La Turquie, de l'empire ottoman à la république d'Atatürk de Thierry Zarcone toujours dans la collection Découvertes Gallimard. Excellent petit ouvrage qui glisse un peu rapidement sur la fin de l'empire ottoman mais pour mieux se consacrer à la naissance de la République turque moderne autour de la figure, exceptionnelle à plus d'un titre, d'Atatürk. Zarcone aborde à la fin de son livre la question très particulière de l'islam dans le système politique turc et les problèmes qu'il pose. J'ai appris beaucoup de chose et je recommande la lecture de ce petit livre à ceux qui doutent de la place de la Turquie dans l'Union Européenne.
Bien ! Tout cela est assez savant et historique, ce n'est pas ce qu'on a envie de lire sur la plage ou dans le bus. Alors, que choisir du point de vue de la fiction ? Quand on pense à littérature turque, un nom surgit immédiatement : Orhan Pamuk, prix Nobel de littérature en 2006. Et l'un de ses romans vient également rapidement à l'esprit : Mon nom est rouge, Prix du Meilleur Livre étranger en 2002. J'ai dévoré en moins de 15 jours ce gros pavé de 736 pages dont l'intrigue ne se déroule pourtant que sur une grosse semaine. L'entrée dans le roman est un peu surprenante, voire déstabilisante, mais elle pose d'emblée une sorte de contrat de lecture, puisque le premier personnage à prendre la parole est mort. C'est son cadavre que l'on écoute. Puis la voix du roman se fait polyphonique, puisque même des personnages abstraits (qui se révèlent bien plus que cela...), comme les couleurs noir et rouge mais aussi la mort, prennent aussi la parole. Pamuk parvient à mêler avec beaucoup d'habileté une intrigue quasi-policière à une réflexion sur la place de la peinture dans l'islam médiéval. L'auteur n'évite cependant pas quelques longueurs dues, me semble-t-il, à une sorte de fascination pour sa propre écriture. Rien de narcissique là-dedans, mais plutôt, un désir d'écrivain de rivaliser avec la peinture et surtout ces petits mondes qu'étaient les miniatures. L'ouvrage développe, en filigrane, tout une réflexion sur le rapport dialectique entre la tradition et le style personnel. L'un des personnage donne de ce dernier cette définition à méditer : "une erreur qui ne provient pas d'un manque de maîtrise, mais émane de l'intérieur de l'âme de l'artiste, cesse d'être une erreur, et devient un style."
 Le roman ne cesse de parler de deux personnages de la poésie perse classique, et de leur représentation : Khosrow et Shirin. A ce jour, je n'ai cependant pas trouvé d'ouvrage en langue française, sur ces deux héros. Par contre, je compte bien investir dans L'art figuratif en islam médiéval de Michael Barry pour comprendre un peu mieux toutes les références aux figures quasi-légendaires des peintres évoqués par les personnages du roman de Pamuk.
Le roman ne cesse de parler de deux personnages de la poésie perse classique, et de leur représentation : Khosrow et Shirin. A ce jour, je n'ai cependant pas trouvé d'ouvrage en langue française, sur ces deux héros. Par contre, je compte bien investir dans L'art figuratif en islam médiéval de Michael Barry pour comprendre un peu mieux toutes les références aux figures quasi-légendaires des peintres évoqués par les personnages du roman de Pamuk. Ensuite, j'ai lu La bâtarde d'Istanbul d'Elif Shalaf, un roman écrit par une auteure turque (même si la traduction française a été faite à partir de l'édition anglaise ?!) et abordant un problème éminemment turc : la question arménienne. Le roman commence vraiment, par la manière de camper les personnages dans leur environnement quotidien, dans la veine des romans socio-critiques anglais, comme ceux de David Lodge. L'humour et la distance ironique sur les personnages sont en effet là, mais l'intrigue bascule aussi dans le fantastique et surtout dans le drame historico-famillial. Sans aucune complaisance pour les Turcs, ni pour les Arméniens, Elif Shafak montre qu'un roman est aussi une manière de contribuer à une réflexion collective sur la mémoire des peuples et le dialogue des cultures. La question que cette auteure aborde semble susciter encore des réactions extrêmement vives en Turquie puisque Elif Shafak, à cause de ce roman, a été traînée en justice pour insulte à l'identité nationale turque. Elle encourait trois ans de prison, mais fut finalement (et heureusement !) acquittée.
Ensuite, j'ai lu La bâtarde d'Istanbul d'Elif Shalaf, un roman écrit par une auteure turque (même si la traduction française a été faite à partir de l'édition anglaise ?!) et abordant un problème éminemment turc : la question arménienne. Le roman commence vraiment, par la manière de camper les personnages dans leur environnement quotidien, dans la veine des romans socio-critiques anglais, comme ceux de David Lodge. L'humour et la distance ironique sur les personnages sont en effet là, mais l'intrigue bascule aussi dans le fantastique et surtout dans le drame historico-famillial. Sans aucune complaisance pour les Turcs, ni pour les Arméniens, Elif Shafak montre qu'un roman est aussi une manière de contribuer à une réflexion collective sur la mémoire des peuples et le dialogue des cultures. La question que cette auteure aborde semble susciter encore des réactions extrêmement vives en Turquie puisque Elif Shafak, à cause de ce roman, a été traînée en justice pour insulte à l'identité nationale turque. Elle encourait trois ans de prison, mais fut finalement (et heureusement !) acquittée.
L'un des personnages de ce roman, Armanoush Tchakhmakhchian, affirme à un moment : "Tu sais, le mot FIN n'apparait jamais quand tu termines un livre. Ce n'est pas comme au cinéma. Quand je ferme un roman, je n'ai pas l'impression de terminer quoi que ce soit, si bien que j'ai besoin d'en ouvrir un autre" (p.117). Elle affirmait là quelque chose que je ressentais sans parvenir à le formuler ! Elle regarde alors les livres qu'elle vient d'acheter : deux Borges, L'Aleph et Fictions, Narcisse et Goldmund de Hesse, déjà lus et hautement appréciés, en ce qui me concerne, mais aussi et surtout, La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, Agonie d'agapè de William Gaddis, Les Mambos Kings d'Oscar Hijuelos, Paysage peint avec du thé de Milorad Pavic, La femme jaune de Leslie Marmon Silko et deux Kundera : Le livre du rire et de l'oubli et La vie est ailleurs. Toute une série de roman, complètement inconnus pour moi et dont certains sont non seulement traduits en français mais aussi disponibles en poche ! Sentant une certaine affinité littéraire avec ce personnage, je me suis fié (avec raison !) à ses choix.
J'ai donc commencé par lire le très court et très, très étonnant Agonie d'agapè de William Gaddis. Un véritable OLNI : Objet Littéraire Non Identifié. Je n'ai jamais rien lu de tel, même si la véhémence du ton, confinant parfois à la paranoïa, n'est pas sans évoquer le Pour Louis de Funès de Novarina. Il est tout simplement impossible (et sans intérêt) de raconter le contenu de ce court récit, mais ceux qui auront la force de se maintenir à flot de ce monologue, découvriront une écriture puissante et maîtrisée derrière la montée de la folie. Je vous renvoie à ces quelques lignes décrivant le projet de cette Agonie.
 Ensuite, j'ai lu l’inénarrable La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. Je me suis beaucoup amusé à lire la progressive conjuration de cette série de personnages loufoques, bouffons, vulgaires, dérisoires et en même temps touchants. Le personnage principal, Ignatius John Reilly, est un vieux garçon, paranoïaque et pédant, d'une fainéantise n'ayant d'égale que sa mauvaise foi, accumulant les situations ubuesques. Le héros est quelque part entre Ubu et Gargantua, avec une touche de The big Lebowski. Voilà un exemple de ce qu'il pense du monde et de lui-même : "décidé à ne fréquenter que mes égaux, je ne fréquente bien évidemment personne puisque je suis sans égal".
Ensuite, j'ai lu l’inénarrable La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. Je me suis beaucoup amusé à lire la progressive conjuration de cette série de personnages loufoques, bouffons, vulgaires, dérisoires et en même temps touchants. Le personnage principal, Ignatius John Reilly, est un vieux garçon, paranoïaque et pédant, d'une fainéantise n'ayant d'égale que sa mauvaise foi, accumulant les situations ubuesques. Le héros est quelque part entre Ubu et Gargantua, avec une touche de The big Lebowski. Voilà un exemple de ce qu'il pense du monde et de lui-même : "décidé à ne fréquenter que mes égaux, je ne fréquente bien évidemment personne puisque je suis sans égal".
Ignatius traine (ou entraine) avec lui une cohorte de personnages allant de l'apprentie effeuilleuse, à sa mère alcoolique, en passant par la secrétaire antédiluvienne et l'homosexuel aux velléités politiques. Leurs calculs et leurs manigances isolées se rencontrent accidentellement pour aboutir à un imbroglio que seul un coup de théâtre peut dénouer. Un très bon roman américain des années 60, dressant un portrait acerbe des États-Unis et des libérations (raciales et sexuelles) qui s'y déroulaient. France Inter a consacré une émission à ce roman.
Pour le moment, je fais une pause dans mes lectures tirées de la liste proposée par Armanoush Tchakhmakhchian, mais je lui fais confiance et lirai la suite avec plaisir.
Pour le moment, je fais une pause dans mes lectures tirées de la liste proposée par Armanoush Tchakhmakhchian, mais je lui fais confiance et lirai la suite avec plaisir.
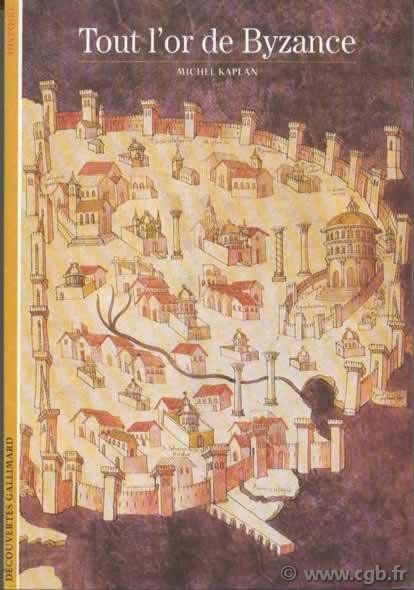




















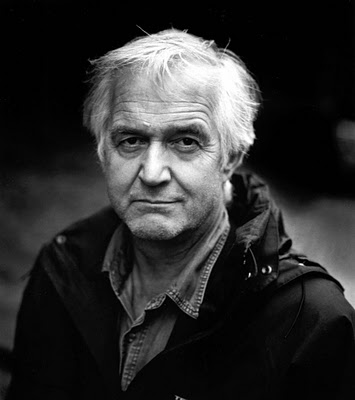




.jpg)
.jpg)



.jpg)



.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
%20Sigi%20M%C3%BCller%201st%20Prize%20SQ4t.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)